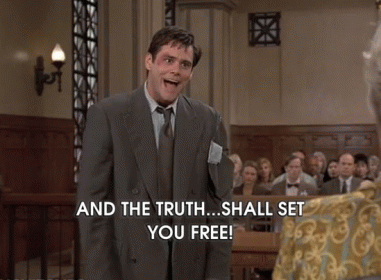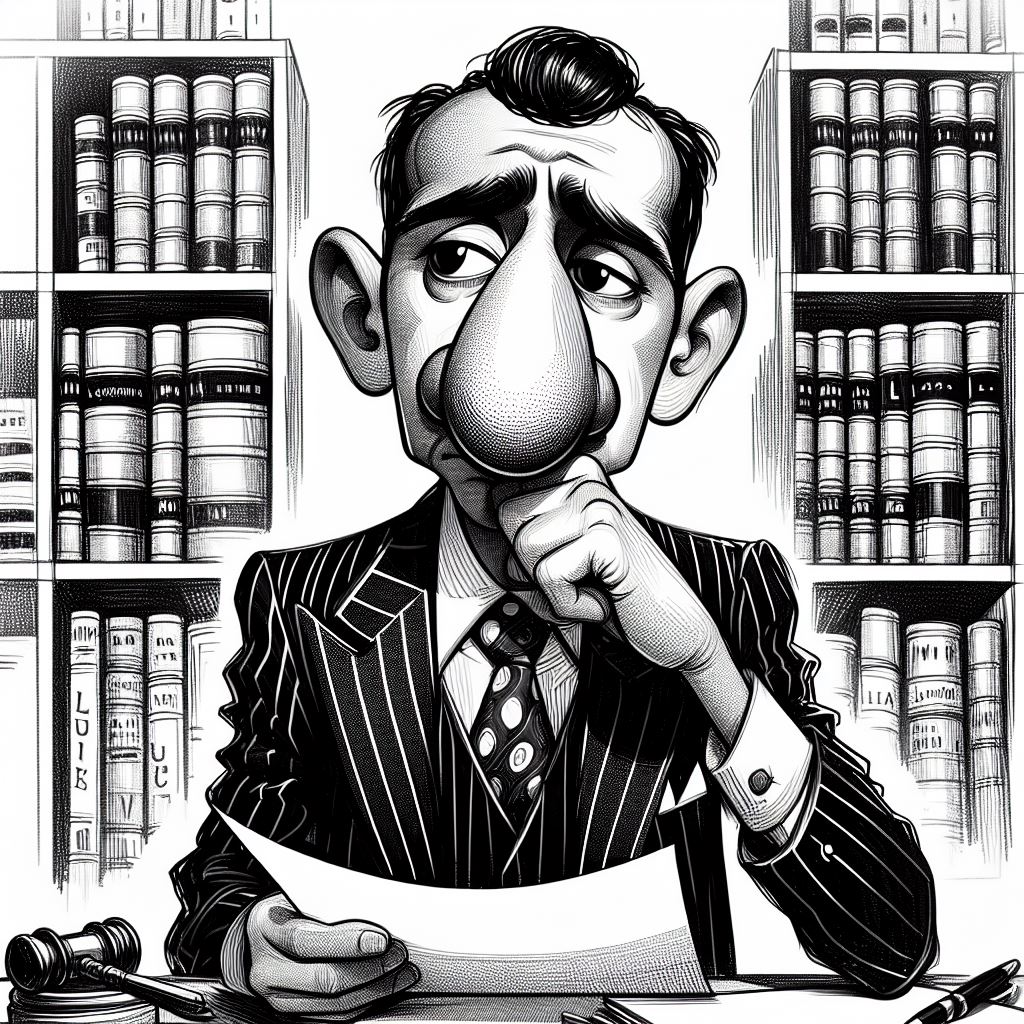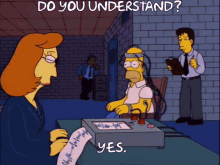Avril…
… où l’on se risque à consulter les augures avant de se découvrir d’un fil, au propre comme au figuré, prudence oblige. L’avocat, tout comme le météorologue, avance masqué : il jauge, soupèse, ne dévoile jamais tout, ni à ses adversaires ni même parfois à ses propres clients. Nous sommes des équilibristes au quotidien, composant avec les giboulées de la procédure, les bourrasques de la déontologie, et les coups de froid de la jurisprudence. Sortir du bois trop tôt, c’est risquer la grippe judiciaire ; rester emmitouflé juste ce qu’il faut, c’est garder la distance nécessaire pour protéger ses intérêts… et ceux de ses clients. En avril, ne perdons pas le fil… et le style.
Le 1er…
… où votre serviteur est informé par Messager Boiteux que, durant les 30 prochains jours, toute décision qui lui sera notifiée sera bienveillante et que, même en cas de rejet, L’État protecteur des institutions et de la Justice supportera tous les frais.
Voilà… Elle est pas belle la vie d’avocat ?
Le 2…
… où s’il ne faut donc pas se découvrir, ne serait-ce que d’un fil, il est également prudent de ne pas s’aventurer dans la nature sans son avocat.
Car, aujourd’hui, tout est matière à discussion dans les arènes judiciaires. Ce qui, il n’y a pas si longtemps, et je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans accrochés à la vérité virtuelle de leur smartphone ne peuvent pas connaître, il n’y a pas si longtemps donc, les victimes d’événements naturels blâmaient la fatalité. Mais plus maintenant. Tout drame appelle un responsable. L’aléa rime désormais avec dommages et intérêts.
L’affaire qui amène votre serviteur ce matin dans ce Tribunal aux confins de la Comté en est un parfait exemple.
Un arbre mort, s’élevant au beau milieu d’une forêt, s’effondre sur une table de pique-nique installée par une association locale sur le territoire communal. Malheureusement, deux personnes étaient assises là. Une part du bon côté en entendant le craquement du tronc qui éclate. L’autre non. Grièvement blessée, elle est aujourd’hui invalide.
Sur le banc des accusés, le garde forestier et le responsable communal des forêts. Ce dernier représenté par votre serviteur. Ils n’ont pas planté l’arbre, bien sûr. Mais devaient-ils et pouvaient-ils l’identifier comme potentiellement dangereux, perdu au milieu de milliers d’autres ?
Savoir qui doit surveiller quels arbres dans une immense forêt, à quelle fréquence, donc déterminer jusqu’où va le devoir de vigilance d’un professionnel de la chose forestière ou d’un milicien tel un conseiller communal bombardé chef du dicastère forêt ? Les contrôles visuels suffisent-ils ? En définitive, à qui la faute quand la nature fait sa loi ?
Et cela change-t-il la donne si nous parlons de forêt communale ou privée ? De sentier officiel ou de simple chemin naturel ? Quid d’une table ou d’un banc, installé par qui et pourquoi dans cette équation ? Chaque élément a son importance dans l’appréciation finale.
Voilà l’enjeu de ce procès.
Le Procureur n’était pas convaincu qu’il existait forcément un responsable. Le Tribunal cantonal lui a tapé sur les doigts : ce n’est pas à vous de décider s’il faut contrôler chaque arbre, c’est au Juge.
Et donc, nous y voilà.
Désavoué, le Procureur a donc dû déposer un acte d’accusation, où l’on sent que le cœur n’y est pas. Tellement qu’il ne comparaît pas aujourd’hui. C’est son droit, mais la partie civile se retrouve ainsi bien seule.
En face, les deux accusés, droits dans leurs bottes si l’on peut dire, avec leurs défenseurs.
L’audience sera rondement menée. Très rondement même. En effet, alors qu’on pouvait s’y attendre, la partie civile ne demande pas à ce que le Tribunal se déplace sur les lieux de l’accident. Ce n’est pas une obligation, mais se rendre à l’endroit précis du drame, voir ce que les acteurs pouvaient ou ne pouvaient pas voir, fait toujours son petit effet. Il est vrai que le dossier contient plusieurs dizaines de photos.
On gagne donc du temps et un écran géant permet à tout le monde de se téléporter dans la fameuse forêt.
Au final, trois théories s’affrontent. Celle de la victime qui prétend que le garde-forestier aurait dû voir l’arbre s’il avait fait correctement son boulot. Et si l’on devait par impossible considérer qu’il l’a fait, le responsable communal devient responsable par ricochet… Celle du garde-forestier. Son avocat plaide qu’il a fait son travail dans la limite de ses prérogatives. Rien à lui reprocher. Et, enfin, celle de votre serviteur. Il n’y a pas de fondement à la responsabilité de mon client. L’accident est un triste coup du sort. Et le dommage qui ne résulte pas d’autre chose ne peut être puni.
Maintenant, il faut attendre le jugement.
Le 8…
… où l’on se retrouve dans l’un des plus beau tribunal d’arrondissement de l’Helvétie (et pour cause, il s’agit de l’ancien Tribunal fédéral) pour un dialogue de sourds.
Deux parties s’affrontent sur une question de vente immobilière. Frauduleuse selon l’acquéreur. Tout à fait conforme selon les vendeurs que je représente.
Dialogue de sourds donc pour cette séance de conciliation, sauf sur un point et c’est ça qui n’est pas banal. Tout le monde s’accorde pour dire qu’il n’y aurait pas de procès si un 3ème larron ne bloquait pas tout le processus d’accord, parce que justement il est en pétard avec tout le monde, acquéreur, vendeur. Et comme il est copropriétaire du terrain adjacent à la surface litigieuse, tout est bloqué…
Comme l’a très bien compris la Juge de la conciliation, aux avocats de retrousser les manches de leurs robes maintenant. Et de trouver un moyen pour faire boire un âne qui n’a pas soif…
Une fois la conciliation échouée la partie demanderesse peut attendre jusqu’à 3 mois pour ouvrir action. Le temps est désormais compté.
Top chrono.
Le 14…
… où les principes du contradictoire, du droit d’être entendu et de l’égalité des parties ne sont pas si évident que ça pour les profanes.
La cliente appelle après avoir reçu l’information du délai imparti à nos adversaires pour répondre à l’appel déposé la semaine dernière.
« Je ne comprends pas pourquoi la partie adverse peut se déterminer sur notre recours, je pensais que seul le Juge allait statuer sur nos seuls arguments. »
« Eh bien, si c’est la partie adverse qui avait fait recours, et qu’on vous dirait que vous ne pouvez strictement pas vous prononcer sur les mérites du recours… ? »
« Vous marquez un point Me. »
La procédure, parfois c’est simple, parfois c’est compliqué, parfois les deux. Cela dépend du point de vue.
Le 16…
… où il est question de recherche de la vérité. Non pas celle avec un V majuscule, mais la vérité judiciaire, celle qui pilote l’instruction, puis conclut le procès en étant exprimée de manière orientée dans les pages du jugement (souvent trop longues et qui masquent à peine l’indigence de la réflexion, mais ça c’est un autre sujet).
Cette vérité, donc, est une fin en soi pour le Juge, mais intéresse moins l’avocat. Il ne défend pas la vérité, mais un client. Et ce qui compte, c’est le dossier. Car c’est avec lui qu’on gagne ou qu’on perd un procès. Cynique ? Non. Les avocats ont un job, celui de défendre. Les tribunaux eux sont là pour faire la part des choses entre les points de vue exprimés. Ils souhaitent alors approcher le plus près possible de cette ombre insaisissable qui se cache derrière le dossier. Tout serait tellement plus facile – croient-ils – si on pouvait s’assurer des déclarations de l’accusé-e ou des témoins.
C’est donc aux détours de ces quelques réflexions basiques qu’on croise Vanessa Codaccioni et son livre Les détecteurs de mensonge; Recherche d’aveux et traque de la vérité (textuel). Son dada ? Les dispositifs qui grignotent peu à peu nos libertés, comme les détecteurs de mensonges. On a du mal à l’imaginer ici, mais, de plus en plus d’États, y compris en Europe voisine, les utilisent dans la justice.
Petit rappel historique pour commencer. Dès 1880, des médecins, des psychologues et des criminologues avaient dans l’idée que le mensonge provoquait des réactions corporelles. Ils essayaient de plonger les mains des suspects dans l’eau, pour voir si elle bougeait, ou écoutaient leur respiration. Plusieurs appareils sont nés pour essayer de mesurer le mensonge. Le « vrai » détecteur de mensonges, appelé polygraphe, naît aux États-Unis en 1920. Des électrodes sont placées sur le doigt, le torse, le bras d’un suspect afin de mesurer des réactions du corps humain à des stimuli. Le mensonge doit s’exprimer par des réactions physiques, telles que l’accélération du rythme cardiaque, de la tension, de la sudation.
Depuis 1930, le détecteur de mensonges n’a plus de valeur de preuve dans un procès pénal aux États-Unis. On a estimé qu’il influencerait trop les jurys. En revanche, son utilisation par la police lors des interrogatoires pour faire avouer les suspects ou sonder l’âme des criminels subsiste. Sur ce point, certaines fictions cathodiques comme Mindhunter sont très réalistes.
Cela dit, le lien entre le mensonge et ces manifestations physiques a-t-il jamais été établi ? La réponse est négative. Les détecteurs de mensonges sont en réalité des détecteurs de stress. Or rien ne permet aujourd’hui de prouver que quelqu’un qui est stressé ment obligatoirement. Cela a notamment été illustré aux États-Unis, dans une affaire de suspicion de transmission de secrets atomiques à des pays étrangers. L’agence nucléaire envisageait de passer 1200 employés au détecteur de mensonges. Les autorités ont alors fait une grande enquête sur les détecteurs de mensonges. Celle-ci a rendu un avis très explicite, disant que rien ne permet aujourd’hui de dire que le stress équivaut au mensonge. Lors d’un interrogatoire, plusieurs facteurs peuvent en effet générer des manifestations liées au stress : l’attitude menaçante de la personne qui mène l’interrogatoire, mais aussi une rage de dents, une chaleur excessive, ou bien la peur d’être discriminé, parce qu’on est une femme, ou parce qu’on est un noir face à un policier blanc. Ces facteurs de stress peuvent donc générer des « faux positifs ». Il s’agit-là d’un vrai problème, surtout aux USA, où, on le voit dans les médias, ces questions sociétales sont généralement au centre du débat.
Plus récemment, la neuro-détection du mensonge s’est développée depuis le 11 septembre. Les services de renseignement américains étaient confrontés à des terroristes qui restaient muets. Le neuro-détecteur de mensonge est alors apparu. Des électrodes sont placées cette fois sur la tête du suspect et visent à repérer un souvenir du crime ou une réaction à l’évocation du crime. Pour la petite histoire, sachez qu’il y a deux types de neuro-détection. Soit le policier va évoquer le crime et regarder si le cerveau « bourdonne », c’est-à-dire si le cortex frontal s’éclaire. Soit il va montrer au suspect une photographie de la victime, de l’arme ou des lieux du crime. Si le cerveau réagit, il va considérer que le suspect est probablement coupable. Techniquement passionnant, mais cela reste une approche sans filet, dont les conséquences peuvent s’avérer très graves, notamment en matière de présomption d’innocence.
Cela n’empêche pas bon nombre de pays d’utiliser aujourd’hui des dispositifs de type polygraphe dans leurs enquêtes. En Europe, la Belgique s’en sert depuis une vingtaine d’années pour les affaires particulièrement graves de terrorisme, de meurtres très violents ou de crimes sans preuves. Le Royaume-Uni, uniquement pour gérer la délinquance et la criminalité sexuelle. Les anciens détenus pour criminalité sexuelle sont suivis à l’aide d’un détecteur de mensonges en vue de prévenir la récidive. Ils y sont soumis tous les six mois, à vie. S’ils échouent au test du détecteur de mensonges, ils retournent en prison. Ce système est pratiqué également au Canada, aux États-Unis, en Russie. En Allemagne, il y a eu des recours au détecteur de mensonges dans les affaires civiles, dans les cas de divorce pour savoir si le conjoint a menti, et dans le cas de dispute de garde d’enfants pour savoir s’il a violenté les enfants. On le voit, l’usage du détecteur de mensonges s’étend donc progressivement.
Dans les procès criminels, seule la Russie, dont la réputation en matière de procès équitable n’est plus à faire, utilise le détecteur de mensonges comme preuve. La Cour suprême russe a considéré que c’était légal. L’Inde a voulu lui emboîter le pas. Par deux fois, des accusés ont été condamnés à la prison à perpétuité sur la base de détecteur de mensonges, mais le verdict a été cassé par la Cour suprême.
On l’a vu juste avant, aux États-Unis, les détecteurs de mensonges ont été écartés du procès pénal dès les années 1930. Mais pour combien de temps encore ? Des neuroscientifiques essaient de les faire entrer à nouveau dans les tribunaux. Ils y arrivent pour le moment uniquement en défense. Les résultats des détecteurs ne peuvent donc pas permettre de faire condamner quelqu’un, mais des accusés peuvent demander à s’y soumettre pour prouver leur innocence. De retour en Europe, saisie du sujet, la CEDH a estimé qu’il était possible d’utiliser les détecteurs de mensonges comme preuve, mais à la condition que cela ne soit pas la seule preuve et que d’autres investigations aient été menées.
Comme on n’arrête pas le progrès, surtout en ces temps d’intelligence artificielle émergente, on va encore plus loin aujourd’hui, avec la surveillance algorithmique, conceptualisée en Israël, tiens donc ! Le principe est d’installer des détecteurs de mensonges aux frontières, notamment dans les aéroports. Ils sont couplés à un agent conversationnel, c’est-à-dire à une machine qui pose des questions et analyse les réactions de la personne : ses yeux, la dilatation de ses pupilles, la fréquence de sa voix, le temps de réponse à la question. Ces données permettent d’établir un score de risque. S’il est élevé, la personne subit une fouille en règle et un interrogatoire poussé. Sans surprise, il a été prouvé que, non seulement l’IA peut avoir des « hallucinations, sans compter que ce test est très discriminatoire, notamment à l’égard de personnes en situation de handicap, ou de migrants qui peuvent avoir un regard plus figé en raison du stress post-traumatique. Ils risquent d’avoir des scores très élevés et d’être considérés comme ayant des intentions malveillantes en termes de sécurité, alors qu’ils sont justes en situation de faiblesse.
Bref, Big Brother is watching us de plus en plus. Sans être alarmiste, on voit quand même que le détecteur de mensonges intègre gentiment les tribunaux, même dans les pays considérés comme « civilisés » en matière de respect des droits de l’accusé. Et avec la montée de la crainte terroriste, en termes de surveillance, il est probable que des neurodétecteurs se développent un peu partout, y compris dans notre Helvétie, et que l’on doive un jour s’y soumettre pour entrer dans un festival ou dans un stade de foot.
Voilà qui ne va pas arranger les files d’attente.