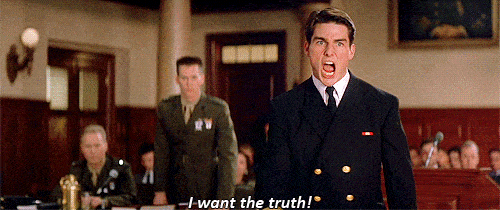Février…
… où quelques signaux alarmants viennent troubler le bon fonctionnement de la mécanique juridique. Malgré que, en ce qui concerne votre serviteur en ce début d’année 2026, il y a désormais dans le rétroviseur plus de chemin parcouru qu’il ne nous en reste manifestement, on constate que le combat de l’avocat reste le même. Non seulement assurer une défense efficace, cohérente et flexible, mais également d’une manière générale le respect des règles de procédures qui garantissent l’État de droit. Et, malgré toutes les jurisprudences du Tribunal fédéral, malgré tous les arrêts la Cour européenne des droits de l’homme, on constate toujours dans certains secteurs de l’autorité que ses acteurs s’affranchissent du minimum légal, et pas par ignorance. Souvent par fainéantise, parce que « faire juste » demande parfois plus d’effort. Quelques fois avec défiance, sachant qu’ils ont de toute manière un coup d’avance. Tout cela est donc bien inquiétant en ce début d’année. Pour paraphraser les Poppys : « Non, non, rien n’a changé. Tout, tout, a recommencé. »
Le 2…
… où l’on est confronté à une situation particulièrement détestable. Une accusation de maltraitance sur enfant portée contre ses parents, mais on ne sait pas exactement par qui et ce qui est reproché.
Mais ce flou n’empêche pas la machine de s’emballe.
L’enfant « sorti » de l’école pour être entendu par la police en catimini, pendant que celle-ci prend contact avec les parents qui sont au travail et à qui on dit qu’ils doivent tout laisser tomber sans, fournir d’explications à leurs employeurs, pour venir répondre à des questions au Poste.
Le soir venu, les parents vous contacte avec la seule pièce qu’ils ont en mains. Reçue de la police le matin. Une décision de l’autorité de protection de l’enfant rendue… il y a six semaines ! Six semaines pendant que cette soi-disant menace planait, on ne sait pas trop où. Six semaines durant lesquelles, paraît-il, il y a quelque part un enfant en danger à la merci de parents inadéquats…
En l’occurrence, ceux-ci sont complètement dépassés par la situation et se demandent d’où viennent ces accusations dont ils n’ont jamais entendu parler, ni de près, ni de loin.
Voilà donc que l’avocat se mue en détective et s’en va aborder les autorités dont il sait que, dans un premier temps, un temps qui peut s’avérer très long, la transparence ne sera pas le maître mot de la communication.
Affaire à suivre.
Le 5…
… où, dans cette profession, lors des nombreux cocktails où nous sommes régulièrement invités (!), on se retrouve souvent à expliquer que notre système pénal est fort différent des séries que la maîtresse de maison regarde sur Netflix.
Aujourd’hui, c’est l’exercice inverse. Lors d’une vidéoconférence organisée en fin d’après‑midi, six heures de décalage horaire oblige, on explique à un américain, prévenu en Suisse, les subtilités de notre système pénal.
Enfin, subtilité est un terme un peu galvaudé. C’est en réalité l’un des piliers de notre système. Du leur aussi. Mais qui s’articule dans nos deux juridictions avec une différence finalement assez fondamentale.
De chaque côté de l’Atlantique, le prévenu a le droit de garder le silence, mais…
…dans notre système judiciaire, l’accusé peut décider de répondre ou non à certaines questions, sans avoir à se justifier, et s’il opte pour la première solution, il conserve le droit de mentir pour se dédouaner de l’accusation. En théorie, du moins, nul ne peut le lui reprocher. En pratique, tous les avocats savent que si le prévenu ne coopère pas, l’accusation prétendra que c’est parce qu’il a quelque chose à cacher (et s’il parle, il est de toute façon coupable aussi). C’est un peu la quadrature du cercle, mais ce n’est pas le débat du jour.
… aux États‑Unis, le prévenu a certes le droit de se taire, mais s’il se décide à parler, il doit s’expliquer sur toute la ligne, pas de faux-fuyants, et il doit obligatoirement la vérité.
C’est là une différence de taille.
Tout système a ses avantages et ses défauts, mais sur celui‑ci, le droit pénal made in Europe a tout de même quelques avantages et garanties supplémentaires pour la personne accusée. Elle ne peut être contrainte de collaborer à aucun moment. Et, contrairement à une idée répandue, ce système n’a pas pour vocation de protéger les coupables.
Il permet à la personne accusée de n’avoir pas à prouver son innocence et de laisser à l’accusation le devoir de faire le boulot.
Il a fallu quand même un bon moment à ce cousin de l’Oncle Sam de se faire à cette idée qu’il est mieux protégé ici que dans son pays.
Si, si, cher client, l’Amérique n’a pas forcément le monopole de l’excellence !
Le 10…
… où il est question d’arithmétique et de bon sens.
Notre droit matrimoniale est devenu, par le biais d’une jurisprudence de plus en plus abscons (incompréhensible pour le commun des mortels, si vous préférez), complètement détachée de la réalité. Et donc de plus en plus difficile à expliquer à nos clients.
Les calculs tarabiscotés que l’on impose aux juges (et donc aux praticiens qui viennent déposer leurs écritures en amont), où il faut jongler avec les charges du ménage qui peuvent être prises en compte, où celles qui ne peuvent l’être, ont un effet supplémentaires qui rend la matière encore plus indigeste.
Alors qu’il fallait quelques pages il y a une dizaine d’années encore pour rendre une décision, certes toujours perfectible, mais néanmoins compréhensible, aujourd’hui calculs et développements s’étalent sur des dizaines de pages, enjolivés de copiés collés d’interminables extraits de considérants issus de précédentes décisions. Bref, plus personne n’y comprend rien, même ceux qui feignent l’inverse.
Et, là, en lisant cette décision, on n’y comprend effectivement plus rien.
L’époux qui gagne grosso modo 9’000.- par mois devrait verser une pension mensuelle de 2’000.- à Madame, laquelle travaille à 100% et gagne dans les 6’000.-, alors que cette dernière ne verse pas un sou à ses deux enfants en formation, restés avec leur père, donc à sa charge, celui-ci devant encore supporter toutes les charges découlant d’une résidence secondaire dont elle est copropriétaire.
Malgré les longues explications détaillées du Juge qui parvient à ce résultat manifestement déséquilibré, force est de constater, avec le client, qu’il y a manifestement quelque chose qui cloche dans le droit matrimonial tel qu’il est appliqué par cette juridiction…
Le 16…
… où après une semaine de vines tentatives, on arrive enfin à joindre quelqu’un au greffe de l’autorité civile en charge du dossier de maltraitance évoqué au début du mois.
Malheureusement, c’est un peu un dialogue de sourds.
Pas d’accès au dossier. De toute façon, nous n’avons pas vraiment de dossier. Il n’y a que la décision de nomination d’une curatrice de représentation de l’enfant dans la procédure pénale. Tout le reste est au Ministère public.
D’accord, mais vous rendez une décision sur la base d’une dénonciation. Vous l’indiquez d’ailleurs. Vous avez bien un dossier.
Oui, mais comme déjà dit il faut voir avec le Ministère public. Nous on ne peut rien faire. Vos clients [les parents, donc] doivent par contre nous dire s’ils sont d’accord avec la décision de nommer une curatrice.
Alors qu’ils ne savent même pas ce qu’on leur reproche ?
Ce n’est pas la question. S’il ne s’est rien passé, tant mieux.
Non, Madame. Pas « tant mieux ». Tout le monde les regarde de travers maintenant à l’école. Si cette histoire ne repose finalement sur rien., si une accusation a été portée à la légère et n’a pas été un tant soit peu questionnée, avant d’envoyer une dénonciation en sachant les conséquences, on ne pourra pas s’en laver les mains et dire « finalement, tant mieux« . C’est grave…
Le 20…
… où un dossier pénal nous confronte à une délicate question devenue récurrente. Celle de savoir s’il est opportun de demander une contre-expertise psychiatrique. Pour guider le Juge sur le terrain de savoir si l’auteur est pleinement responsable de ses actes, partiellement ou… pas du tout. Vaste question qui nous renvoit à ce qui pourrait devenir un cas d’école.
Dans une jurisprudence récente (6B_162/2024 jointe à 6B_176/2024) la 1re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF) a tranché une affaire portant sur une mesure thérapeutique institutionnelle avec, en toile de fond, un homicide commis par un auteur souffrant d’un trouble schizo-affectif grave.
En première instance, le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois avait reconnu le prévenu coupable d’assassinat et l’a condamné à 14 ans de peine privative de liberté, avec cumul d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP et d’un internement, le tout avec exécution anticipée.
Sur appel du prévenu, la Cour d’appel pénale a acquitté celui‑ci des chefs de lésions simples, vol, meurtre et assassinat, et a ordonné à la place une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), en considérant qu’il était irresponsable au sens de l’art. 19 al. 1 CP.
Le Ministère public et le prévenu ont tous deux recouru au Tribunal fédéral.
Le dossier comportait deux expertises psychiatriques avec des appréciations complètement divergentes sur la responsabilité, le pronostic et le type de mesure adéquat. Le TF relève la divergence importante des évaluations et l’existence de questions restées ouvertes, notamment quant au lien entre le trouble psychique et les actes incriminés et quant au pronostic sous traitement institutionnel ou autre. Dans ce contexte, il considère qu’une nouvelle expertise est nécessaire, en particulier pour confronter les experts précédents et clarifier les points de désaccord, avant de pouvoir statuer de manière fiable sur la responsabilité et la mesure.
Exceptionnellement ici, le TF admet donc les deux recours, celui du prévenu et celui du Ministère public. Mais il ne tranche pas. Il renvoie la cause au canton pour nouvelle décision.
C’est là qu’on en arrive au sujet du jour au travers des conséquences de l’arrêt fédéral. La Haute Cour impose pratiquement aux juges cantonaux de mettre en œuvre une expertise complémentaire notamment sur la question de la culpabilité (assassinat vs irresponsabilité) qui découlera de la confrontation des deux premiers points de vue divergents.
L’expert judiciaire serait-il donc devenu l’oracle salvateur…
… reléguant le juge au statut de greffier de la science médico-légale ? Derrière l’illusion rassurante de la nécessité de l’intime conviction des magistrats pour condamner se profile une nouvelle réalité procédurale : la délégation de la production de la vérité judiciaire aux blouses blanches.
Le recours devenu pratiquement systématique à l’expertise (puis à la contre-expertise), face à un point de friction du dossier de l’instruction, devient singulièrement, mais gentiment, une constante. Les experts ne sont plus de simples couteaux suisses réglant en arrière-plan les question non juridiques. Ils servent maintenant d’emblée d’écran de fumée à l’aveu d’impuissance, parfois trop rapidement consenti, de l’institution judiciaire face à des matières, certes complexes, mais propices aussi à une réflexion préalable, avant de décider trop vite de filer la patate chaude à un expert.
Face à cette incompétence désormais très (trop ?) vite assumée sur les terrains médicaux ou scientifiques, le statut de l’expertise mute radicalement. D’un simple avis destiné à éclairer la cour, elle devient la sentence elle-même. Ces conclusions soudain deviennent déjà la décision. Le juge n’est plus qu’une sorte de porteur d’eau qui officialise en homologuant l’appréciation technique au travers du jugement.
Là est le danger qui guette la machine judiciaire. Celui de placer au premier plan un technicien qui, loin des réalités d’une instruction contradictoire, va décider seul du sort de la cause, alors qu’il n’est au bénéfice d’aucune légitimité pour punir ou absoudre. Car quel tribunal de première instance, même armé d’une sagacité juridique dans la norme, osera systématiquement se poser en détenteur solide du verdict, en osant si c’est nécessaire affirmer péremptoirement dans les considérants de son jugement qu’une expertise psychiatrique ou médico-légale est, finalement, tout bien pesé, à côté de la plaque ?
Cette abdication rampante du juge se heurte d’ailleurs à l’un des piliers cardinaux de notre système pénal : le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 CPP). En bref, le magistrat est tenu d’évaluer librement et sans a priori chaque élément du dossier, éléments dont la supériorité de certains par rapport à d’autres ne peut être autoproclamée à l’avance et surtout pas par quelqu’un qui n’est pas une partie.
C’est dans ce contexte que la cause 6B_162/2024 suscite un intérêt pas seulement académique, mais bien pratique. Que faire face à des scientifiques pouvant se contredire ouvertement sur le sort d’un même individu ? Une situation d’ailleurs extrêmement courante en matière psychiatrique, une science que l’on peut qualifier de « pas tout à fait exacte » selon le mot de notre Confrère français Jean-Yves Leborgne.
Cette question aux contours chaotique est bien illustrée dans cet arrêt 6B_162/2024.
Deux psychiatres ont livré des rapports aux antipodes. Le premier retenait une responsabilité restreinte, envoyant l’auteur au cachot pour 14 ans ; le second diagnostiquait une irresponsabilité totale, justifiant un acquittement pur et simple par la Cour d’appel, assorti d’une mesure thérapeutique en institution.
Comment expliquer un tel écart ? Votre serviteur n’a pas d’éléments de réponse, n’ayant pas eu accès au dossier complet, notamment aux travaux des experts. Difficile donc de se lancer dans une analyse pertinente. Une explication plausible réside peut-être dans le fait que, comme en philosophie, il y a plusieurs écoles en psychiatrie. Suivant le courant qu’observe tel ou tel expert, psychanalytique ou biologique par exemple, la démarche s’articule différemment. Sans compter que le contact entre l’expert et le sujet de l’expertise peut varier durant le temps de l’instruction. Rencontrer un patient emprisonné ou dans son cabinet, ce n’est pas la même chose.
Dans l’affaire en question, la Cour d’appel avait choisi de privilégier un avis au détriment de l’autre, ce que le TF a qualifié d’injustifiée, donc d’arbitraire, selon le jargon juridique consacré de ce type de décision. Pour garantir une décision « juste », une confrontation entre les experts s’imposerait impérativement, afin d’élucider et de clarifier ces contradictions.
Faudra-t-il en arriver à un match de catch entre les deux experts dans l’enceinte judiciaire pour séparer le bon grain de l’ivraie ? Pas sûr que la légitimité des juges et de leur jugement y gagne.
Bon gré mal gré, nous aboutissons ainsi à un paradoxe. Théoriquement modeste auxiliaire de justice, purement consultatif, les Juges ont la tentation d’abdiquer et d’ériger l’expert en véritable décideur dans le prétoire. Auparavant, on l’appelait à la barre pour tenir la lanterne d’un savoir obscur et en éclairer les faits. Aujourd’hui, c’est bien lui qui finit par tenir la plume rédigeant le verdict. Cette nouvelle chorégraphie, un brin hypocrite tout de même, permet de sauver les apparences structurelles : la Cour conserve sa majesté et le monopole de juger, tandis que l’expert exerce, dans l’ombre de son cabinet, l’ingénierie de la qualification. La science dicte l’issue, le juge se borne à y apposer le sceau de l’État.
Ce constat est volontairement provocateur. Cette affaire, comme quelques autres avant elle, illustre néanmoins une tendance réelle, surtout face à des magistrats débordés qui veulent se simplifier la tâche. Mais juger un Homme, c’est tout sauf… simple. Et il faut bien y réfléchir, à deux, voire trois ou quatre fois pour se forger une intime conviction…
Et c’est là qu’on en arrive à la conclusion de ce billet : le rôle de la défense dans tout cela ?
Face à une expertise dont le magistrat instructeur aura de plus en plus tendance à se servir de béquille, et qui pourrait s’avérer, dans certains aspects, à plusieurs égards problématiques, la demande d’une contre-expertise s’impose presque.
Comme on vient de le relever, la garantie du droit à un procès équitable, et donc le droit à un second avis, s’impose presque de lui-même par la nature même de la discipline médicale en cause : la psychiatrie. Elle est une « science qui n’est pas tout à fait exacte ». Donc, le diagnostic de l’expert comporte inévitablement une dimension subjective.
Mais c’est à double tranchant, sous l’angle de l’argument central du doute qui doit profiter à l’accusé.
Face, tu perds. La seconde expertise confirmant en tous points les aspects problématiques de la première. Pile, tu gagnes. Il y a désormais un contrepoids dont cette jurisprudence permet de soutenir qu’il doit être clarifié. Et si c’est impossible, alors on en revient au doute !