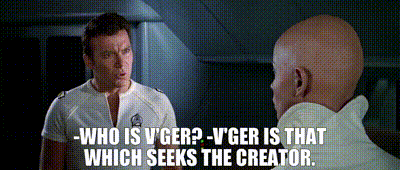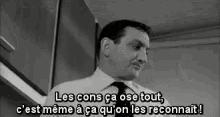Octobre…
… où le vent fait craquer les branches, la brume est là, dans sa robe blanche, y a des feuilles partout, couché sur nos robes corbeaux. Octobre tient enfin sa revanche. Les dossiers traînent sur le bureau. Moins romantique que les feuilles qui volent dans le square… Il y a toujours un brin de spleen à l’entame du dernier trimestre. Bon, difficile de ne pas sentir la nostalgie qui perlent aux fenêtres du #FaireOffice, quand, mû par un élan rétro bobo, on ressort le vinyle de la grand-mère à moustache pour accompagner nos cogitations vespérales…
Le 1er…
… où les vidéoconférences font désormais partie du quotidien. A un point tel que certains clients parlent à leur avocat comme avec leurs potes… en voiture et en roulant, smartphone les filmant en train de conduire !
Monsieur, je me permets de vous signaler que vous commettez une infraction, là. Merci de vous garez tout de suite.
Ah bon ?
Le 2…
… où la cliente – qui a fait ses humanités et connaît donc le concept de la présomption d’innocence – nous demande si sa plainte est forcément vouée à l’échec, car elle ne dispose malheureusement pas d’un polaroid de l’accusé en train de commettre son forfait ?
Ce fameux doute qui profite à la relaxe. On a tendance à le brandir souvent un peu naïvement comme si c’était l’arme absolue de la défense. C’est souvent parce qu’on n’a pas grand chose d’autre à dire pour sortir de l’impasse celui que tout accuse et qui persiste pourtant à nier.
Nier le crime est la vocation première de l’accusé. Mais, pour la plupart, il ne s’agit que d’un pur réflexe de protection. L’avocat doit rarement composer avec un client de la trempe d’un Raskolnikov qui nie, mais en même temps, veut élever son acte à une dimension supérieure.
En version simplifiée, dans “Crime et Châtiment”, le héros de Dostoïevski, un étudiant en droit (!), commet un meurtre et passe la plus grande partie de l’histoire à nier son crime, même face à des preuves accablantes. Il justifie son acte par une théorie selon laquelle certaines personnes exceptionnelles ont le droit de transgresser les lois pour un bien supérieur.
Dans les méandres de nos dossiers, le crime est le plus souvent commit par pure opportunité aveugle. L’occasion fait le larron, justification insuffisante pour transcender l’acte et ouvrir la voie à l’avocat d’une plaidoirie qui pourrait s’engager sur des sentiers moins balisés, pour le plus grand plaisir de l’auditoire. L’opportunisme certes, quand il n’est pas question que de pure bêtise.
Donc le doute qui profite à l’accusé est souvent le fond de commerce par défaut de la défense.
Et c’est là que l’on vient rassurer notre cliente en évoquant ses limites, que l’on ne connaît que trop bien, pour intervenir des deux côtés de la Barre. Elles sont principalement de deux types.
Si on n’a pas de photo de l’auteur, un faisceau d’indices concordants peut suffire à établir la culpabilité. Plusieurs éléments mis bout à bout, même s’ils ne sont pas chacun décisifs, peuvent ensemble former un tableau cohérent. Et, devant un Tribunal, la liste des arguments possibles n’est pas limitative. Témoignages, documents écrits, comparaison de données, etc. peuvent se combiner de manière convaincante.
C’est comme face à un tableau de Paul Signac. De près, c’est un fouillis de milliers de petits points de couleur. Isolément, ils semblent désordonnés et sans signification. Mais en prenant du recul, ils se fondent pour révéler une scène parfaitement compréhensible. C’est cette perspective globale qui donne du sens à l’œuvre… ou au crime.
L’autre limite au doute qui profite à l’accusé, c’est le Juge lui-même. S’il est d’emblée convaincue que la culpabilité apparaît nettement plus probable que l’innocence, l’oreille qui écoute l’accusation sera beaucoup plus attentive que l’autre.
Voilà comment ce métier peut devenir passionnant, même dans une affaire a priori banale. Si l’on parvient à s’affranchir des clichés, omniprésents dans un prétoire (l’accusé a déjà un lourd casier, il ne peut être que coupable…), l’analyse et l’ordonnancement des pièces du puzzle, puis leur présentation convaincante au Juge est un travail intellectuel motivant.
Le 7…
… où il est question de Vérité (une fois de plus), de bonne foi et d’incompréhension face à leurs contraires.
Il n’y a pas que les contraintes procédurales qui provoquent des réactions épidermiques. Rien de tel pour faire monter la pression chez un client que de lui lire les libertés prises avec la réalité dans les faits, que la partie adverse expose au juge, pour asseoir ses prétentions pharaoniques. Certains diront non sans pertinence que chaque avocat est uniquement le porteur de la vérité de son client. Donc, pourquoi s’indigner ?
C’est juste. Mais, pas toujours. Là, le client, qui s’échauffe, égrène un a un les documents prouvant sans l’ombre d’un doute que la demande n’est qu’un ramassis de contre-vérités (traiter quelqu’un de menteur peut relever du droit pénal, d’où la prudence d’utiliser un ton mesuré dans certaines circonstances…).
Et donc de s’indigner que « l’autre » avocat ose écrire de pareilles âneries, sans le moindre fondement. Pis, notre adversaire va même jusqu’à citer, en détournant leur sens, les documents qui, s’ils les avaient bien lus, contredisent manifestement la thèse de son vaurien de client.
Quel discours adopter pour calmer les velléités de guerre sainte de notre client ?
Restons zen. Cette situation n’est pas si inédite. Expliquer qu’il y a deux cas de figure. Soit la partie adverse a délibérément mal renseigné son défenseur, ce qui est courant (on ne le sait que trop bien) et celui-ci a pris le risque d’écrire des choses fausses, au lieu de d’approfondir avant de déposer.
Encore eut-il fallu qu’il ait un doute sur le côté plausible de l’histoire de son client. Quoique, ici, comme on l’a souligné juste avant, il produit quand même des pièces qui attestent le contraire de ce qu’il écrit.
Ce qui nous amène à la seconde hypothèse, il le fait sans vergogne, sans se soucier de l’impression qu’il va créer auprès du juge, une fois qu’il aura en mains les deux versions du litige. Et de ce qui va en résulter, un naufrage aux frais de celui qu’il défend.
Dans les deux cas, c’est un véritable sabordage de leurs propres chances de succès. Mais, dans la dernière éventualité, c’est inquiétant. Car on présente sur près de 30 pages des faits pour la plupart erronés, alors que la moitié aurait suffit pour déposer une demande à peu près cohérente, toujours infondée, mais en gardant une chance de pouvoir repartir avec quelque chose dans les mains lors de la séance de conciliation, prélude à tout procès civil.
Alors que, là, toutes velléités de conciliation sont d’emblée balayées par le défendeur, offusqué – pour rester nuancé – par une tel ramassis de bêtises. Tu veux un procès, tu l’auras !
Et c’est justement ce qu’on veut de l’autre côté de la Barre. Même si c’est contraire aux intérêts du client. Cette conception du métier est malheureusement de plus en plus répandue, concurrence oblige. Certains remplacent la réflexion au détriment d’une posture théâtrale, sensée impressionner le client. Jusqu’à ce qu’il reçoive la note d’honoraires finale de son défenseur… et celle de son adversaire en prime, parce qu’il a gagné une procédure menée à l’envers du bon sens.
Bon, cela fait un brin donneur de leçons, mea culpa. Mais, pas tant que ça. Avant d’écrire ce billet, j’ai échangé avec quelques Confrères à qui je prête quelques qualités d’humanistes. Le constat est le même sur cette dérive. Et de nous dire que nos Ordres respectifs feraient bien d’attirer l’attention des nouveaux venus sur ce danger. Certes, il faut amener des sesterces dans la caisse, mais facturer en débitant des fadaises ne fidélisera jamais le client qui cherche dans l’avocat avant tout le bon conseil. Inutile de le saigner sur un dossier, car il ne reviendra jamais plus. Pire, il prendra en grippe la profession et ira chercher chez les nouveaux thuriféraires du conseil juridique low cost (et sans responsabilité) sur le net des réponses inconsistantes.
Moralité. Ne pas tomber dans le même piège. La tentation de répondre coup pour coup peut être grande, mais il est crucial de rester professionnel et de ne pas adopter la même stratégie. La procédure est une course de fond, pas un sprint. Le juge – on l’espère – finira par comprendre par lui-même qui est de bonne foi dans ce litige et surtout qui se moque de Dame Justice.
La patience et la réflexion sont nos meilleurs alliés pour défendre nos clients. Mais, c’est parfois dur à leur expliquer…
Le 14…
… où l’IA commence gentiment à s’installer dans le quotidien de l’avocat.
Discussion autour d’un contrat de prestations à remodeler, pour une entreprise de services. Le client nous a envoyé deux drafts. Je vous ai balancé rapidement quelques idées qui vous montre ce que j’aimerais mettre en place comme structure. Il y a les idées principales et quelques suggestions. Vous me dites ce que vous en pensez.
Et donc, voici 2 docs, à la présentation léchée, très flatteurs pour le regard grâce à une hiérarchisation des points soi-disant clés, logo de l’entreprise bien mis en valeur, etc. C’est joli, a priori complet et cela semble très professionnel.
Sauf que, dès qu’on y regarde de plus près, certaines formulations sont inadéquates, des points se contredisent ou s’excluent sans logique et le texte contient plein de déclarations d’intention ou messages destinés à attirer le client. Autant de choses qui doivent être bannies d’un contrat digne de ce nom.
Bienvenu dans le monde de l’IA !
Le client ne s’en cache pas lors de l’entretien. J’ai bricolé ça avec ChatGpT. Après plusieurs tentatives et corrections, voilà ce que ça m’a donné. Pas mal hein ?
Pas mal en effet. En tous cas assez étonnant. Mais maintenant le travail de l’avocat commence. Remettre l’église au milieu du village et donner à ce contrat un ton professionnel et un vrai cadre juridique, à partir du document de base, dans lequel le client a pu mettre en avant ses idées et ses besoins, ce qui nous fait gagner un peu de temps. Mais il a aussi laissé de côté des points fondamentaux dans un contrat, parce que l’IA n’a pu (encore) pu les identifier. Peut-être que ses prompts n’étaient pas assez précis. Ou alors, V’Ger (les initiés comprendront) s’est égaré en cours de chemin.
Donc, à tous ceux qui prédisaient la fin de la profession d’avocat supplanté par l’IA qui allait régler tous les travers de la profession (notamment les délais et les coûts), on peut répondre que ce n’est pas encore pour demain. L’IA ne va pas remplacer l’avocat, du moins pas encore ! Elle va par contre modifier son travail en apportant une aide, mais pas la solution qui sera façonnée par l’expérience de l’homme de lois à partir d’un résultat brut, balancé d’on ne sait où par la machine.
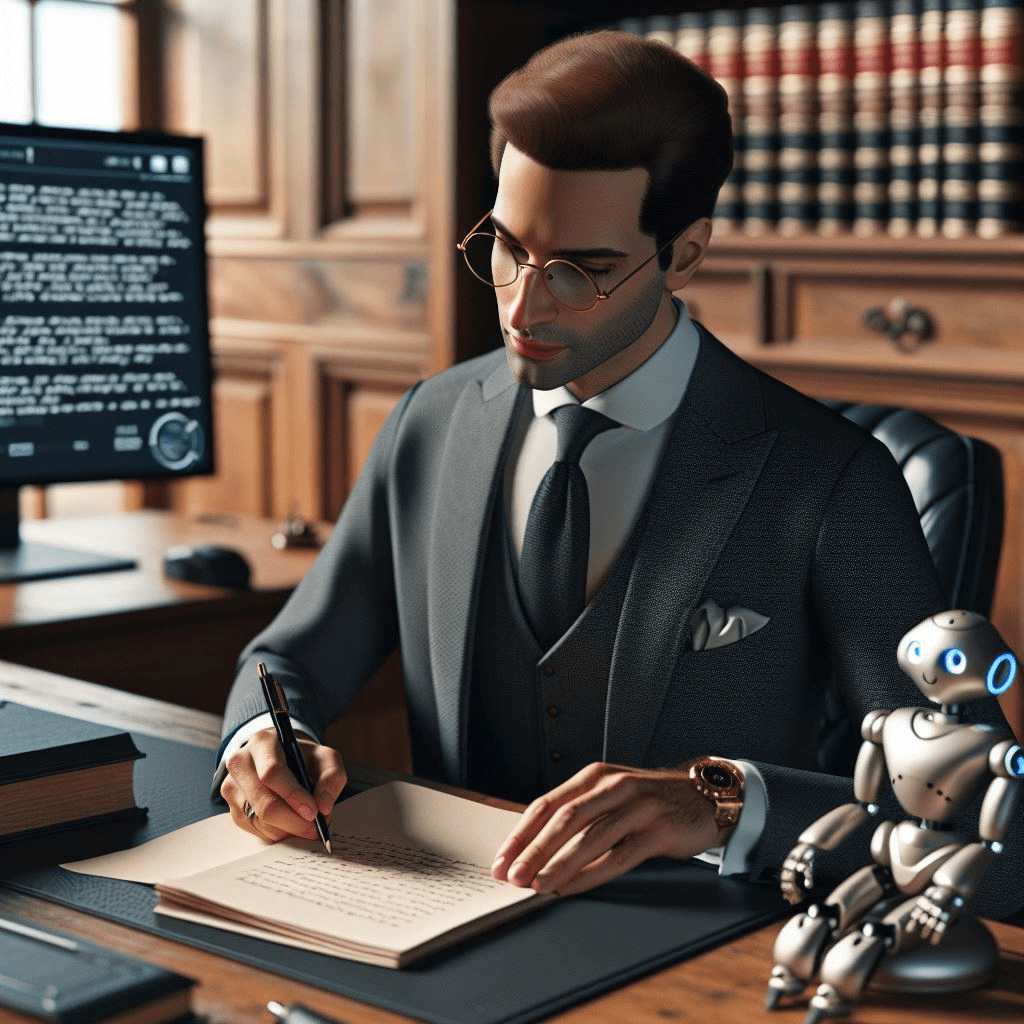
Plus l’avocat sera apte à dialoguer de façon efficiente avec son nouvel assistant virtuel, et à le façonner patiemment, plus le résultat sera pertinent. Mais cela va prendre encore un peu de temps.
Et pour conclure avec la démonstration que l’IA, c’est génial, mais ce n’est pas encore la solution à tous nos petits problèmes organisationnels non plus : votre serviteur qui a rendez-vous avec son client tout à l’heure répond à l’un de ses mails via CoPilot pour lui demander si on peut repousser le rdv d’une petite heure ? Non, il ne peut pas. Réponse via CoPilot que cela ne fait rien, je m’adapte et que je le remercie pour sa flexibilité ! Alors que justement, il ne peut pas être flexible ! Je laisse partir quand même le mail.
Lors du rendez-vous, je demande au client ce qu’il pense de mon dernier courriel. Ce n’est pas de vous. Pourquoi vous me remerciez ? Juste. Et lui comment avez-vous deviné que ce n’est pas moi mais ChatGpT qui a rédigé le projet de contrat ?
Par sa conclusion notamment. C’est le propre d’une réponse donnée par l’IA de conclure toujours avec une phrase flatteuse destinée à résumer ce qui précède.
Google est en train paraît-il de mettre au point un logiciel qui permettra de détecter si un texte a été généré par l’IA. Pas besoin pour l’instant… ça se voit !
Le 15…
… où l’on est confronté à une question existentielle récurrente de l’avocat : déterminer – en fonction de ce que la/le client-e nous a apporté – la meilleure défense possible pour préserver ce qui peut encore l’être, voire récupérer tout ou partie de la casse.
Généralement, la résolution de ces équations obéit à une logique prévisible. Sans compter l’expérience du mandataire, apport crucial suivant la complexité du cas ou les émotions sous-jacentes du dossier.
Mais, parfois, le dilemme est tout de même un brin déroutant : les actions de la partie adverse sont-elles le fruit d’une intelligence retorse, ou bien la démonstration d’une stupidité complète ?
La seconde réponse est malheureusement la plus courante. Le quotidien de l’avocat est très souvent aux antipodes de ce qu’on voit à la télé. Dans les fictions juridicos-judiciaires, le « méchant » fait montre d’un intellect au-delà de la norme. La beauté du diable… Normal, au cinéma, le rôle du bad guy est souvent attribué à un acteur de renom qui peut y donner toute la mesure de son talent. Combien de fois vous êtes-vous dit à la fin du film : le gentil était un peu niais, mais alors, le méchant, c’était quelque chose ! Chez les justiciers, il n’y a guère que Batman pour nous offrir des abîmes d’ambivalence… Mais, ça, c’est un autre débat.
Revenons donc à notre pain quotidien juridique, où c’est donc plutôt l’inverse du génie qui se présente. Hélas pour nos petites cellules grises… et tant mieux pour la personne que l’on défend. Affronter le mal absolu peut rarement être considéré comme un challenge réjouissant.
Donc, généralement, la catégorisation intellectuelle de celle que l’on nomme poliment la partie adverse ne fait pas trop débat. On voit le plus souvent tout de suite à qui on a à faire et ce qui motive le litige.
Quelque fois pourtant, comme aujourd’hui, à l’heure de faire le point sur la situation avec notre cliente dans une affaire civile immobilière, la question reste toujours entière et en devient même fascinante face aux dernières interventions de notre contradicteur : très intelligent ou complètement stupide ?
Ce questionnement inhabituel n’est pas seulement une curiosité intellectuelle qui peut faire débat autour d’une tasse de thé. Sa compréhension, puis sa résolution, devient essentielle, avant de pouvoir définir la bonne stratégie pour la suite de l’affaire..
Comment réagir de manière adéquate lorsqu’on se retrouve face à ce qui apparaît de prime abord au mieux comme les errances juridiques d’un entrepreneur arrogant au pire comme un début de tentative d’escroquerie ? Gestion irréfléchie ou coup de maître habilement déguisé sous les oripeaux de l’incompétence crasse ? Bon, si l’on en est à se poser encore la question, la bonne réponse est rarement la seconde option. Quand on ne comprend pas, c’est rarement parce que c’est génial. Mais, pour l’instant, un doute subsiste et cette réponse demeure essentielle, car elle va influencer directement la suite des opérations.
Partons d’abord du postulat le plus intéressant : l’adversaire est très intelligent et il essaie par conséquent de nous déstabiliser. Sa démarche peut sembler incohérente, à première vue du moins, mais chaque mouvement est calculé pour atteindre un objectif précis. Il anticipe nos réactions pour essayer de nous manipuler et nous mener à commettre une erreur. Il est donc possible qu’il s’agisse d’une stratégie de dissimulation, la plus payante selon L’art de la Guerre. Sauf que l’on trouve rarement des adeptes de Sun Tzu en face de soi.
Mais cela ne dispense pas d’appliquer les préceptes millénaires de ce stratège, soit que le général intelligent doit savoir se montrer flexible et adapter sa tactique en fonction des développements du conflit sur le terrain.
Si, au contraire, l’adversaire est complètement à côté de la plaque (tout en étant persuadé du contraire, cela va le plus souvent de pair), il nous facilite indéniablement la tâche. Le litige présente alors nettement moins de risque. Sauf sur le plan financier. Les démarches judiciaires inconsidérées ont toujours un coût pour leur victime, car l’indemnisation au final ne couvrira jamais l’entier du préjudice consécutif aux démarches qu’il a fallu entreprendre pour s’en sortir.
Sun Tzu préconisait d’envoyer des espions dans le camp adverse. Option rarement envisageable dans les prétoires. La meilleure attitude reste une vigilance accrue face à chaque mouvement adverse et une capacité à rebondir rapidement s’il le faut, en ayant pris le soin d’anticiper l’un ou l’autre scénario possible. Et si, vraiment, on est face à quelqu’un de stupide, d’arrogant, et dangereux pour ses partenaires commerciaux, se concentrer sur l’exploitation de ses erreurs. Non pas pour avoir la joie revancharde de lui mettre le nez dessus, mais pour limiter les désagréments chez notre cliente.
Le 17…
… où il est question de Molière, d’Académie et de respect à propos de ce qui se cache sous nos belles robes d’avocat unisexes.
De manière plus prosaïque : peut-on encore aujourd’hui, sans risquer l’anathème, dire cher confrère en s’adressant à une avocate ?
Si la question est posée, c’est bien parce que le risque existe bel et bien, votre serviteur venant d’en faire l’expérience !
Alors quid ?
Commençons par un peu d’étymologie (nom féminin au demeurant). Selon le Littré, consœur se dit des femmes associées à une même confrérie, et des religieuses du même couvent ou du même ordre. Cela suppose que ce mot, contraction du latin cum (avec) et du mot sœur, ne peut être utilisé que par une coreligionnaire envers son alter ego du même sexe.
Le Barreau, peuplé comme tout le monde le sait de mâles réac et profondément misogynes, et cela depuis bien avant les Lumières, doit-il quand même battre sa coulpe et sacrifier ses traditions aux diktats sociaux actuels ?
Petit retour sur les formules « historique » d’abord pour commencer à comprendre ce nouveau problème, apparemment devenu fondamental, et qu’on voudrait désormais nous obliger à résoudre, avant de pouvoir commencer à s’intéresser à la défense des client-e-s, notre seule vocation.
Pour s’adresser correctement à une avocate, la formule mon cher confrère est aujourd’hui à proscrire, car elle avait pour fonction d’abréger le désuet Monsieur cher confrère. Elle ne saurait plus avoir cours aujourd’hui, où les femmes atteignent gentiment la parité au sein du barreau. On n’appelle pas une femme Monsieur et cela ne date pas d’aujourd’hui.
Et ne parlons même pas de le remplacer par Madame et cher confrère qui n’a que pour effet de souligner que l’interlocuteur est une femme avant d’être une avocate, ce qui ne résout rien et créé une distance inappropriée.
Cher confrère reste la formule la plus utilisée entre avocat et avocate. Certes, elle efface le féminin, mais elle ne crée, s’agissant du barreau, aucune inégalité à l’égard des mandataires impliqués dans les échanges professionnels.
A ceux, essentiellement masculins, qui seraient tentés par un chère confrère ou ma chère confrère, merci de ne pas ajouter l’hérésie grammaticale à la polémique. Aucun camp n’y gagnerait autre chose que la palme de l’absurdité. On ne dit pas pour un homme un sentinelle, un recrue ou un vedette de cinéma que diable !
A noter, puisque nous en sommes au cher confrère, que certaines avocates insistent pour être appelées ainsi, autant par respect de la tradition que le souci de ne pas vouloir féminiser un titre qui induirait une différenciation qui ne les intéresse pas. Le souci est d’ailleurs le même chez certain-e procureur-e.
Ce bon sens mérite d’être salué à une époque où ceux qui veulent provoquer les débats clivants sur les réseaux, agissent par souci de se mettre en lumière, ce dont les privent leurs qualités intellectuelles dans d’autres débats.
Mais trêve de polémiques à propos des thuriféraires de la nouvelle dictature de la bienséance. Revenons à nos moutons, pardon nos brebis… Ok, mea culpa, mea maxima culpa, arrêtons de titiller les egos chatouilleux, avec des calembours à deux balles.
Donc, parmi les autres formules inadéquates entre avocat-e-s, il y a aussi le chère Madame, croisé à quelques occasions, et qui se passe de commentaires. Là, on nie carrément l’appartenance à la profession.
On en arrive donc à chère consœur, formule tout à fait adéquate, en tous cas entre deux avocates. Et pour les autres ?
Pourquoi ne pas leur laisser tout simplement le choix ? Puisqu’aucune des deux formules (confrère/consœur) n’est réductrice, sauf pour celles et ceux qui veulent à tout prix qu’il en soit ainsi.
On m’a lancé aujourd’hui un manque de respect, en concluant avec la formule avec mes respectueuses salutations. C’est généralement dans ce contexte que l’on va justement manquer de respect à son interlocuteur. Et c’est bien le cas ici.
Contraindre un avocat de s’adresser à une avocate en l’appelant chère consœur, c’est – pour certains qui comme votre serviteur ont été élevés avec les « classiques » – lui imposer de se considérer quelque part comme un femme, au moins dans le rapport professionnel. On a tous une part de féminité en nous, j’en suis intimement convaincu. Elle s’exprime à sa façon, dans certaines circonstances, mais ça c’est notre jardin secret. Par contre, imposer ce diktat au nom de prétendus convenances bâties à coup d’interdits et de menaces de se voir opposer l’opprobre sociale, ne paraît pas la méthode la plus appropriée pour obtenir justement ce respect que l’on revendique et qui n’a – la plupart du temps – jamais été foulé aux pieds.
Laissons donc le bon sens et la sensibilité de chacun guider nos rapports professionnels et choisir la formule qui lui semble appropriée. Le respect n’y perdra rien, au contraire…